

Saviez-vous qu’en Occitanie, le mariage entre agriculture et énergie solaire connaît une croissance fulgurante ? L’agrivoltaïsme, longtemps perçu comme une curiosité, séduit aujourd’hui de plus en plus d’exploitations agricoles toulousaines. Face aux défis climatiques et à la pression sur les terres, cette alliance innovante offre une réponse adaptée au contexte local, permettant de conjuguer production agricole et énergies renouvelables. Découvrons pourquoi cette tendance s’impose dans la région.
Définition et contexte
L’agrivoltaïsme est une approche qui mixe la culture ou l’élevage et la production d’énergie solaire sur le même terrain. Ce modèle cherche à optimiser l’usage des terres agricoles, en couvrant deux besoins essentiels : nourrir la population et produire de l’énergie propre. Contrairement aux centrales photovoltaïques classiques, qui prennent toute la place et empêchent la culture, l’agrivoltaïsme garde le sol disponible pour l’agriculture.
L’agrivoltaïsme repose sur des solutions simples et souples, qui permettent de faire coexister panneaux solaires et travaux agricoles :
- Les panneaux sont placés en hauteur ou sur des structures mobiles pour laisser passer la lumière et le matériel agricole.
- Des rangées espacées facilitent la culture et le déplacement des machines.
- Des panneaux flottants peuvent même être installés sur des bassins pour soutenir l’aquaculture.
- Les systèmes s’adaptent à l’élevage, en servant d’ombre ou d’abri aux animaux.
Cette technologie innovante aide à réduire la dépendance au charbon ou au pétrole. En produisant de l’électricité sur place, elle rend les fermes plus autonomes et diminue leur facture énergétique. En 2020, on comptait déjà près de 5 gigawatts de capacités agrivoltaïques dans le monde.
Toutes les terres ne conviennent pas à ce modèle. Les sols très fertiles et les cultures qui ont besoin de beaucoup de lumière peuvent perdre en productivité si l’ombre des panneaux est mal gérée. Mais bien pensée, l’agrivoltaïsme protège aussi les cultures : elle limite les dégâts causés par la chaleur, la grêle ou le soleil fort, et permet parfois des rendements plus réguliers.
Ce modèle s’adapte aux réalités locales, que ce soit pour la culture de légumes, la vigne, l’élevage ou l’aquaculture.
Enjeux économiques et environnementaux
L’agrivoltaïsme attire de plus en plus d’agriculteurs car il offre un vrai complément de revenu. Les exploitants peuvent louer une partie de leur terrain pour installer des panneaux solaires ou vendre l’électricité produite. Ce gain financier permet de stabiliser leur activité, surtout face aux prix changeants des produits agricoles. Cela aide aussi à financer la transition écologique de leur ferme, un point crucial pour rester compétitif. En France, la surface dédiée à ces projets reste faible (environ 0,1 % de la surface agricole utile prévue d’ici 2028), mais le potentiel est énorme avec 60 à 80 GWc possibles d’ici 2050, soit sur 20 000 à 30 000 fermes.
Sur le plan environnemental, l’agrivoltaïsme combine culture ou élevage avec production d’énergie solaire, sans bétonner les terres agricoles. Les panneaux peuvent protéger les cultures du soleil fort ou de la grêle, ce qui limite les pertes liées aux intempéries. Ils réduisent aussi le stress hydrique, car l’ombre crée un microclimat qui garde l’humidité du sol, ce qui baisse la consommation d’eau pour les parcelles irriguées. Ce système aide à lutter contre l’érosion des sols et favorise le bien-être animal, surtout pour les pâturages. La production d’énergie locale, renouvelable, contribue à la réduction de l’empreinte carbone du secteur agricole, en phase avec les objectifs de transition énergétique fixés par l’État.
Avant de lancer un projet d’agrivoltaïsme, il faut bien étudier la faisabilité, choisir la bonne technologie et préparer le terrain. Ce soin est essentiel pour que l’installation ne gêne pas la production agricole.
Impacts positifs sur la biodiversité et le microclimat :
- Favorise le retour de certaines espèces (insectes, oiseaux, petits mammifères)
- Améliore la couverture végétale sous les panneaux
- Réduit les pics de température au sol
- Maintient une humidité plus stable pour les plantes
Avantages pour les exploitations

L’agrivoltaïsme donne la chance de produire de l’énergie solaire tout en gardant les terres agricoles utiles pour les cultures ou l’élevage. Les panneaux n’enlèvent pas la place aux plantes, ni aux animaux. Ils se placent au-dessus des champs ou des pâturages, ce qui permet de garder la même surface cultivable. Dans beaucoup de pays, dont la France, la loi protège ce principe : tant que le sol reste fertile et les fonctions écologiques intactes, l’exploitation n’est pas vue comme une perte d’espace rural.
Les structures agrivoltaïques changent facilement selon les besoins d’une ferme. On peut choisir la hauteur, l’orientation et l’espacement des panneaux pour s’adapter à chaque culture ou type d’animal. Les modèles mobiles sont utiles pour changer la lumière reçue selon la saison ou la météo. Par exemple, un éleveur peut lever les panneaux pour laisser passer plus de lumière en hiver, ou les incliner pour donner plus d’ombre en été. Cette flexibilité aide aussi pour les machines agricoles qui passent sous les structures.
L’autonomie énergétique devient une vraie force avec l’agrivoltaïsme. Les exploitants profitent de plusieurs avantages :
- Alimentation des systèmes d’irrigation sans dépendre du réseau.
- Fourniture d’énergie pour le stockage au froid ou la transformation sur place.
- Recharge des véhicules et tracteurs électriques.
- Sécurisation des bâtiments contre les coupures de courant.
- Vente du surplus d’électricité pour une source de revenu stable.
Les retours d’expérience montrent que l’ombre partielle protège les cultures du stress thermique, des brûlures et de la grêle. Les rendements deviennent plus stables, avec parfois même une hausse de la production, surtout dans les régions chaudes où la consommation d’eau baisse de 20 à 30 %. Les animaux profitent aussi de l’ombre en été, ce qui limite les coups de chaleur et améliore le bien-être. Enfin, les récoltes sont plus homogènes et, dans certains cas, il est possible de cultiver sur trois saisons au lieu de deux.
Innovations technologiques
L’agrivoltaïsme marie la production d’énergie solaire et l’agriculture sur un même terrain. Cette approche limite l’artificialisation des sols et optimise l’espace, ce qui répond aux besoins croissants de durabilité. Les structures de panneaux solaires s’adaptent maintenant à des cultures variées ou à l’élevage. Il existe des modules surélevés pour permettre la circulation du bétail, ou des installations à hauteur variable pour les cultures basses comme les salades ou les fraises. Pour les grandes cultures, des structures modulaires couvrent de larges surfaces tout en laissant passer la lumière.
Le pilotage automatique de l’orientation et de l’inclinaison des panneaux est devenu courant. Ces systèmes ajustent la position des panneaux tout au long de la journée pour capter au mieux la lumière et fournir de l’ombre selon les besoins des plantes. Cela aide à réduire la température du sol et protège les cultures durant les vagues de chaleur, tout en stabilisant leur croissance. Les panneaux peuvent produire de l’énergie près de 12 heures par jour, ce qui apporte un rendement énergétique élevé.
Des dispositifs mobiles existent aussi. On peut déplacer certains panneaux au gré des saisons ou pour répondre à des besoins ponctuels, par exemple lors de la récolte ou du passage du bétail. Cette flexibilité séduit les agriculteurs qui veulent ajuster leur système sans modifier toute l’infrastructure.
| Type d’exploitation | Structure modulable | Pilotage automatique | Dispositif mobile | Taux d’autoconsommation |
| Grandes cultures | Oui | Oui | Limité | 80% |
| Maraîchage | Oui | Oui | Oui | 80% |
| Élevage | Oui (surélevé) | Oui | Oui | 80% |
L’installation de ces systèmes reste complexe. Il faut prendre en compte l’accès aux machines, la sécurité, la gestion de l’eau, et la stabilité des structures. Pourtant, le recyclage des panneaux peut atteindre 85%, ce qui limite l’impact environnemental. L’agrivoltaïsme offre ainsi une source de revenu stable en conjuguant production agricole et autonomie énergétique.
Cadre légal et démarches
L’agrivoltaïsme s’inscrit dans un cadre légal clair, marqué par la volonté de conjuguer production agricole et énergie solaire. La loi sur l’accélération de la production d’énergies renouvelables, en vigueur depuis avril 2024, vise à simplifier et encadrer le développement des installations photovoltaïques sur terres agricoles. Ce décret impose que l’activité agricole reste le cœur de l’exploitation. Les panneaux ne doivent pas entraîner une conversion du sol, mais bien compléter la production agricole. Par exemple, la culture doit rester possible sous les panneaux, et le rendement ne doit pas baisser. Les autorités exigent que la coactivité soit réelle et mesurable, pour éviter les dérives vers des centrales solaires déguisées.
La France a accordé une grande importance à l’agrivoltaïsme, qui bénéficie souvent des aides de la politique agricole commune (PAC). Cela encourage les agriculteurs à s’engager dans des démarches innovantes, tout en conservant l’accès aux soutiens financiers européens. Un suivi précis est mis en place : un bilan du décret du 8 avril 2024 est prévu après un an, afin d’évaluer les effets sur les cultures et la qualité des sols.
Les porteurs de projets doivent suivre une procédure stricte. Les démarches administratives sont détaillées dans le tableau ci-dessous :
| Étape | Description |
| Étude préalable | Analyse d’impact agricole et environnemental |
| Dépôt de dossier | Dossier à la préfecture ou autorité compétente |
| Consultation | Information et consultation des parties prenantes |
| Autorisation | Délivrance après vérification des critères |
| Suivi régulier | Rapports annuels sur la production et la coactivité |
Les obligations de suivi et de transparence sont fortes. Les exploitants doivent transmettre des rapports annuels sur la production agricole et énergétique, la biodiversité, et l’impact sur le sol. Cela permet de distinguer clairement les projets agrivoltaïques des projets réalisés sur terrains non agricoles, qui visent à accélérer le développement du photovoltaïque sans lien agricole.
Bonnes pratiques
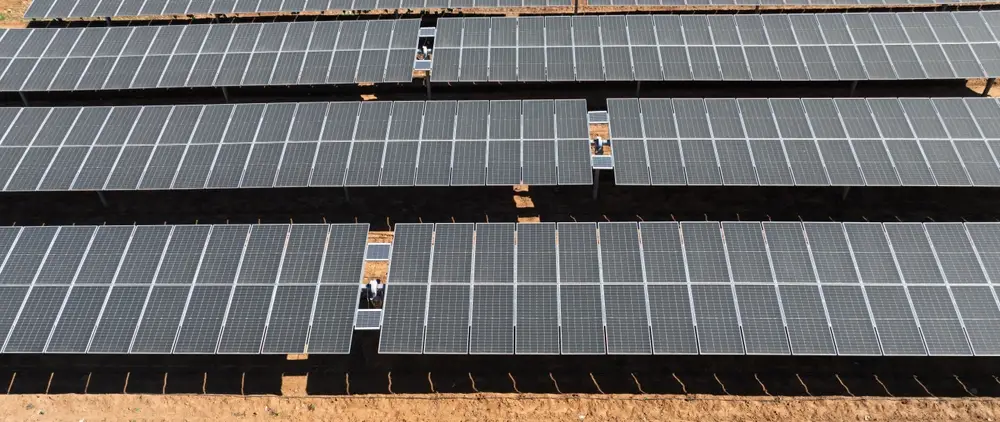
L’agrivoltaïsme attire de plus en plus d’exploitants agricoles parce qu’il apporte des solutions simples et concrètes. Il permet d’optimiser les rendements, de diversifier les revenus et d’aider la transition écologique. Pour que ces projets fonctionnent bien, il faut suivre quelques étapes clés.
Impliquer les collectivités locales et les acteurs agricoles dès le début aide à adapter le projet au terrain et à la culture locale. Par exemple, des réunions régulières avec les agriculteurs du secteur, les techniciens agricoles et les élus permettent d’éviter des erreurs et de gagner du temps lors des démarches. Cela donne aussi une chance à chacun de faire entendre ses besoins, comme l’accès à l’eau ou la préservation des terres arables.
Adapter les structures et les équipements au type de culture ou d’élevage est essentiel. Pour des cultures maraîchères, il faut choisir des panneaux surélevés qui laissent passer la lumière. Pour l’élevage, des structures robustes sont nécessaires pour assurer le passage des animaux. Certains exploitants choisissent des panneaux fixes, d’autres des panneaux qui bougent selon le soleil, ce qui peut améliorer le rendement énergétique et agricole. Cela rend parfois possibles de nouvelles cultures qui n’auraient pas poussé sans l’ombre partielle créée.
Planifier la maintenance régulière des installations assure la sécurité du site et la production d’électricité. Il s’agit de vérifier les fixations, de nettoyer les panneaux et de surveiller le câblage électrique. Par exemple, une ferme équipée de 9 438 panneaux peut produire jusqu’à 4 567 MWh par an, mais seulement si tout fonctionne bien. La maintenance aide aussi à garder un taux d’autoconsommation de 80 % ou plus.
Checklist pour documenter et partager les résultats :
- Noter les rendements agricoles avant et après installation.
- Suivre la production d’électricité chaque mois.
- Enregistrer les coûts et les économies générés.
- Partager les retours sur le bien-être des animaux ou la gestion du sol.
- Faire un bilan annuel pour comparer les objectifs et les résultats obtenus.
Pièges à éviter
L’agrivoltaïsme attire de plus en plus de fermes, mais il cache des écueils bien réels. La tentation de chercher le profit énergétique, parfois au mépris des rendements agricoles, reste l’un des principaux pièges. Choisir d’installer des panneaux sur des terres fertiles, riches en limons et profondes, peut vite devenir un mauvais calcul. Une baisse de lumière de près de 30 % sous les panneaux n’est pas rare et cela réduit la croissance de cultures comme le blé ou les légumes. L’objectif premier de l’agriculture reste la production d’aliments, pas la production d’électricité. Les projets doivent viser en priorité les friches, zones économiques ou sols déjà artificialisés, pas les terres arables de haute qualité.
Le choix des équipements compte beaucoup. Des structures mal pensées ou trop basses gênent le passage des machines agricoles et rendent certaines tâches impossibles. Parfois, elles peuvent même blesser les cultures ou bloquer la circulation de l’eau et de l’air. Un exemple simple : un système mal placé peut empêcher le passage d’un tracteur, forçant des manœuvres risquées ou coûteuses. Il faut donc bien étudier la hauteur, l’orientation et l’espacement des panneaux.
Le respect du cadre légal est non négociable. Les règles évoluent vite et sont strictes : il s’agit de ne pas artificialiser les sols ou transformer une zone agricole en espace construit. Les sanctions peuvent aller jusqu’au démantèlement des installations, avec des coûts élevés à la clé. Une veille réglementaire et des autorisations claires sont indispensables.
Enfin, il faut anticiper les frais cachés, notamment pour l’entretien, la gestion de la végétation, ou la remise en état des sols après démontage. Parfois, la réhabilitation d’un sol compacté ou appauvri coûte cher et prend du temps. Une analyse des impacts sur l’écosystème et les sols doit précéder tout projet, pour éviter des conséquences durables.


